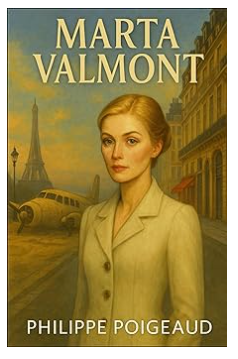Mémoire tragique du Corps expéditionnaire brésilien en Europe
Les carnets d’un des « pracinhas » déployés en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale
Ce n’est qu’aujourd’hui, huit décennies après le débarquement du premier contingent brésilien en Italie, que le manuscrit, sauvé par l’historienne Cristina Pellegrino Feres, a été mis au jour. Chercheuse au Laboratoire d’études sur l’ethnicité, le racisme et la discrimination (LEER) de l’Université de São Paulo (USP), Mme Feres a analysé l’histoire du Corps expéditionnaire brésilien, en se concentrant sur des personnes ordinaires dont la vie a été transformée par des événements historiques.
« Je ne m’intéresse pas aux données sur les batailles, sur la stratégie militaire, je m’intéresse à l’homme au combat, à la valorisation de l’individu dans l’histoire », a-t-elle expliqué à des journalistes de la BBC et de Folha de São Paulo. À la fin des années 1990, Christina Feres a reçu d’un ami de la famille de Waldemar Reinaldo Cerezoli une photocopie des pages du journal.
Comme elle n’effectuait pas encore de recherches sur le sujet, elle a laissé le carnet en réserve jusqu’à ce qu’elle décide, en 2020, d’en analyser le contenu.
En novembre 2023, elle a publié le livre A dupla face da guerra : À FEB pelo olhar de um prisioneiro dans lequel, en plus de reproduire le texte du journal dans son intégralité, elle interprète et met en perspective le récit, en se basant sur des sources académiques et des documents historiques.
« Le 15 juillet (1944)
Nous sommes bloqués sur ce bateau depuis trois samedis. Ils disent que nous arriverons demain. Aux dernières nouvelles, nous allons en Italie et nous descendrons au port de Naples. Je ne pense pas que nous retournerons un jour au Brésil…
J’ai beaucoup rêvé de ma famille. Il y a une chose à laquelle je ne me suis pas encore habituée, c’est de ne manger que deux fois par jour.
Nous allons être très proches de l’ennemi, mais que pouvons-nous attendre d’autre ? Peut-être que nous nous battrons bientôt. Enfin, à 4 heures du matin, nous avons reçu la nouvelle tant attendue : nous arriverons tôt demain matin. Je sors enfin de cette terrible cave, mais Dieu seul sait ce qui nous attend à l’extérieur ».

Ces lignes ont donc été écrites par le caporal Waldemar Reinaldo Cerezoli, l’un des 25 000 Brésiliens envoyés en Europe pour combattre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été écrites sur le navire américain General Mann, qui transportait le premier groupe du Corps expéditionnaire brésilien (FEB).
Il y avait 5 800 hommes à bord, dont la plupart étaient des pracinhas comme on appelait les Brésiliens déployés pour combattre aux côtés des Alliés (Royaume-Uni, France, Union soviétique et États-Unis) et qui n’étaient pas des militaires de carrière.
Ils ont quitté le port de Rio de Janeiro le 29 juin, sans savoir quand ni où ils débarqueraient. Au cou, ils portaient une plaque de reconnaissance militaire permettant de les identifier en cas de décès.
Waldemar Cerezoli a survécu et, avec lui, son journal, dans lequel il a consigné les détails de sa routine pendant les 381 jours qu’il a passés à l’étranger, dont 142 en tant que prisonnier de guerre dans un camp (Stalag) allemand.
Le carnet, de 98 pages remplies au stylo bleu, est revenu dans les bagages de l’ancien combattant en 1945 et a été conservé par sa famille après sa mort en 1975.
De nombreux soldats ont consigné par écrit leur expérience du conflit, contrairement aux instructions du ministère de la Défense de l’époque, qui interdisait aux soldats de tenir un journal.
Habitant de la ville de Ribeirão Pires, à São Paulo, qui était à l’époque un district de Santo André, Waldemar a été enrôlé dans l’armée en 1941.
Selon son certificat de service, il était un soldat qui s’est distingué par sa discipline, sa volonté et son endurance physique pendant l’entraînement.
Le journal révèle une autre facette de la pracinha : celle d’un jeune homme de 24 ans qui s’ennuie de sa famille, qui abandonne sa vie tranquille de postier pour aller manier une mitrailleuse sur le front et qui n’a pas le courage de dire à sa mère qu’il a été appelé à combattre en Europe, il préfère dire qu’il se trouve dans le nord du Brésil.
Son récit commence lorsqu’il embarque à Rio de Janeiro le 29 juin 1944 et se poursuit quotidiennement jusqu’au 30 octobre, juste avant son emprisonnement.
Les épreuves de la captivité ont également été consignées, mais sous une forme résumée, probablement après leur libération.
La dernière entrée du carnet est un poème daté de janvier 1946, six mois après son retour au Brésil.
Selon le journal, le calvaire du groupe a commencé pendant le voyage en bateau, dormant dans une cale pleine de rats, dans une chaleur infernale et avec une nourriture insuffisante.
« La plupart de mes collègues sont malades. Heureusement, je m’habitue à voyager, mais je suis de plus en plus triste, car je m’éloigne de plus en plus de mon pays et j’ai peu d’espoir de le revoir un jour. Nous mourons de faim sur le bateau, où nous n’avons que deux repas par jour, et je n’arrive pas à m’habituer à cette nourriture américaine, où tout est sucré.
La nuit, c’est la misère, toutes les lumières s’éteignent tôt et nous devons rester dans le noir avec les rats, et la cale est insupportablement chaude ! Tous les jours, nous avons des instructions pour abandonner le navire, c’est la pire des galères ! ».
Les privations se sont poursuivies après le débarquement dans le port de Naples. Les soldats dormaient dans l’herbe, se réveillaient avant le lever du soleil pour des séances d’entraînement épuisantes et mangeaient des repas en conserve.
À Naples, les soldats brésiliens découvrent une misère qu’ils étaient loin d’imaginer.
« 5 août.
Je discutais avec les vieux Italiens et j’étais stupéfait de les entendre me raconter les barbaries commises par les Allemands lorsqu’ils passaient par ici. Je leur ai apporté deux boîtes de conserve et ils ont été très contents, me donnant en échange une gourde de vin.
L’après-midi, je me suis changé et je suis allé me promener dans la ville de Tarquinia. Je suis rentré tôt parce que la ville ne vaut rien, elle est toute détruite. Il n’y a que du vin ».

L’une des plus grandes angoisses de Waldemar était l’absence de nouvelles de sa famille. Il a écrit à sa mère et à sa petite amie, mais contrairement à ses camarades, il n’a pas eu de réponse.
« J’ai écrit 18 lettres et je ne sais pas ce qu’est une réponse, peut-être pensent-ils que je suis mort » , déclare-t-il le 13 août.
Le mois suivant, alors que son régiment se trouve déjà au milieu des tirs croisés, les premières lettres lui parviennent.
« 23 septembre.
Toute la nuit, l’artillerie ennemie a tiré sur nous. J’ai pris mon petit déjeuner à 8 heures et j’étais en train de coudre quand le lieutenant m’a appelé et m’a remis deux lettres de ma mère et une de Cida. Personne ne peut dire à quel point j’étais heureux ! J’ai reçu une photo et de bonnes nouvelles de chez nous.
Demain, nous attaquerons, et maintenant je mourrai heureux parce que j’ai eu des nouvelles de ma famille pour la première fois ».
Waldemar est parti au front deux mois après son arrivée en Italie. Il emporte avec lui sa mitrailleuse, qu’il appelle mon chat.
« 25 septembre.
Nous sommes sur la ligne de front, je me suis mis en position avec ma mitrailleuse. Maintenant, ce n’est plus une instruction, c’est la réalité. J’étais à la mitrailleuse quand j’ai entendu des bruits à quelques mètres devant moi, mais comme il faisait nuit, je ne voyais rien. On m’a donné l’ordre d’ouvrir le feu et, pour la première fois, j’ai tiré pour tuer ».
L’histoire est devenue plus dramatique, avec des confrontations directes et la mort de compatriotes.
« 27 septembre.
Je n’ai jamais vu la mort d’aussi près. Un caporal est mort près de moi et quatre ont été blessés. Nous avons avancé à nouveau et mon capitaine nous a ordonné d’ouvrir des tranchées, car nous allions passer la nuit sur la défensive.
J’ai creusé un trou et mis mon chat en position de tir. J’étais en position et il a commencé à pleuvoir. Nous sommes restés sous la pluie jusqu’à l’aube. À 6 heures du matin, le serpent s’est remis à fumer : j’ai ouvert le feu et j’ai tiré jusqu’à ce que le canon du chat devienne rouge. À 7 heures, le feu s’est arrêté et l’ennemi a battu en retraite ».
Le même jour, le régiment de Waldemar amène trois prisonniers allemands, qui arrivent presque nus.
« Ils étaient fous de faim et de soif. Notre capitaine leur a donné des boîtes de conserve et je leur ai donné de l’eau que j’avais dans ma gourde ».
La situation des Brésiliens est également précaire. « Je suis sale comme un cochon, je n’ai même pas enlevé mes bottes depuis cinq jours. Je n’ai pas pris de bain depuis 15 jours, mais c’est malheureusement la guerre qui est ainsi (…) À 7 heures du matin, j’ai préparé mon lit dans un poulailler, mais je n’ai pas pu dormir, car les poux m’ont attaqué. Pire que les Allemands ! ».
L’histoire de Waldemar s’est achevée le 30 octobre, date de sa dernière bataille, avant d’être capturé dans la vallée de Serchio en Toscane. Lui et ses camarades tentèrent de résister, abrités dans une maison abandonnée : « Il était environ 11 heures du matin et j’avais déjà une faim et une soif insupportables. Je suis monté à l’étage et j’ai vu par la fenêtre que l’ennemi avait déjà encerclé la maison (…) Tant que j’avais des balles, je tirais pour tuer. Quand mes 3 000 tirs de mitrailleuse ont été terminés, j’ai repris mon fusil et j’ai continué à tirer. Nous tirions à deux ou trois mètres et la haine se lisait sur le visage de l’ennemi. (…) J’ai vu une grenade passer par la fenêtre et je me suis couvert le visage avec mon bras en attendant l’explosion. J’ai senti un coup à la tête et j’ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Puis j’ai vu mon bras blessé et j’ai senti du sang couler le long de ma jambe gauche. J’ai voulu marcher, mais je n’y arrivais pas.
J’ai regardé le sergent et j’ai vu du sang sur son bras, qui se tordait de douleur et dont le bras droit était cassé. À côté de moi, Hamilton gisait dans une mare de sang. Un éclat d’obus lui avait coupé une artère ».
Ils seront expédiés au Stalag VII-A, le plus grand camp de prisonniers de guerre de l’Allemagne nazie, situé dans la ville de Moosburg en Bavière.
Prévu pour 10 000 prisonniers, il en accueillait plus de 76 000 au moment de sa libération par l’armée américaine le 29 avril 1945.

Waldemar, s’il a échappé à la mort, a gardé de nombreuses séquelles notamment psychologiques, qui l’empêchèrent de travailler régulièrement. Ni l’État brésilien ni les Alliés ne lui sont venus en aide. Il avait pourtant des crises de larmes, ses mains tremblaient et il lui arrivait de perdre soudainement connaissance. Il est décédé à l’âge de 55 ans, en 1975, officiellement d’une leucémie.
Dans un texte, intitulé Essayez de me comprendre, il appelle à ne pas être jugé et donne l’impression qu’après cette expérience, il n’a plus jamais été le même.
« Ne me condamnez pas comme mauvais, essayez de me comprendre. N’oubliez jamais que je me suis temporairement séparé de ce monde et que je suis parti à la guerre, dont beaucoup ne sont pas revenus ».