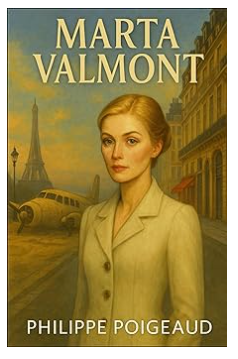2018…
L’écrivain et journaliste d’extrême droite, Paul-Henry Lizotte, plus connu sous le pseudonyme de Ferdinand (il signait ainsi dans l’hebdomadaire Minute dans les années 60 puis dans Valeurs Actuelles jusqu’à ces dernières semaines) vient de passer l’arme à gauche à l’âge de 79 ans dans son appartement de la rue Bernouilli à Paris. Sa fille, Chantal Lizotte-Daoust, s’est empressée de rendre public un document explosif qui prouve sans ambiguïté possible que Marcel Forast, ancien député et éphémère ministre de de Gaulle, a fait déporter des dizaines d’enfants juifs en 1943. Et ce, en dehors de la rafle des 23 et 24 janvier, à Marseille. Pire, la pièce est accompagnée d’une note manuscrite paraphée par Lizotte en personne.
Il affirme avoir informé maître Maurice Douvier de l’existence de ce document en 1998, au moment du procès Forast à Marseille. L’avocat Douvier, alors plus médiatisé sur la scène mondaine parisienne et tropézienne que dans les palais de justice, avait obtenu l’acquittement de l’ex-commissaire de police marseillais au bénéfice du doute. À l’époque Douvier n’en avait rien dit, et Lizotte non plus. On ne sait pas pourquoi le polémiste a préféré garder cette pièce par-devers lui. Peut-être pour éviter la prison à celui qu’il avait défendu à plusieurs reprises notamment à la télévision dans une émission de Michel Polac en 1985. Forast avait alors été brièvement mis en cause pour son rôle durant l’occupation. D’ailleurs à cette époque Jean-Denis Marcel, Résistant communiste, était également venu témoigner en faveur de celui qui reçut des mains du Général la Médaille de l’Ordre de la Libération en janvier 1946. Improbable sous-secrétaire d’État entre 1959 et 1960, Marcel Forast a totalement disparu de la circulation. Tout comme son avocat quarante ans plus tard. En effet, Maurice Douvier, 61 ans aux fraises, a cessé toute activité dès la fin du procès. Lui aussi s’est retiré non seulement de la scène médiatique qu’il appréciait tant et qui le lui rendait bien, mais aussi de la vie professionnelle. Il s’est replié en Bourgogne où il refuse de répondre aux journalistes. Répondra-t-il au juge Goudreau ? Devait-il porter ce document (que nous publions ci-dessous) à la connaissance de la Cour ?
C’est ce que pense en effet Me Isabelle Dutreux. Elle a été chargée par plusieurs associations de déposer plainte contre Douvier.
1.
Dieu existe me disait-il. Et il ajoutait dans un murmure délicat, comme pour s’excuser de je ne sais quel péché irrémissible :
« La preuve, je ne l’ai jamais rencontré… mais la musique est là, celle vous laissant perdre un peu de votre arrogance. Pachelbel ou Grieg ».
Il s’appelait Victor Greimas. Il était grand. Ses cheveux avaient été noirs et ses yeux furent toujours sombres. Son allure générale pouvait faire penser à une sorte de banquier, de chef d’entreprise ou d’affairiste quelconque. Mais il ne fut jamais rien d’autre qu’un marquis français. Un marquis fauché. Mais là-bas, à Mauthausen, riche, pauvre, chômeur, paysan, ouvrier ou patron, ça ne signifiait pas grand-chose.
Victor le savait tout comme ceux partageant avec lui l’horreur quotidienne d’être nés ici plutôt qu’ailleurs, d’être juif, tzigane, communiste, sodomite ou bêtement français.
Il a été un peu tout cela à la fois.
Des Juifs, il avait l’amour irraisonné de la fatalité et des Tziganes l’insouciance poétique ; des communistes, l’esprit de révolte et des sodomites, peut-être la folle conscience de la transgression habituelle à peine voilée.
Il était Français jusqu’au bout des ongles (ils lui furent méthodiquement arrachés) et des papilles se passionnant pour un cru recherché ou un chapon de Bresse rôtissant paresseusement au commencement d’une matinée automnale.
J’ai rencontré Victor au début des années 1990, dans un bar de Chalon-sur-Saône. Il est mort il y a maintenant dix ans. Je me suis longtemps demandé si Greimas était son vrai nom tant le personnage était mystérieux. Mais il s’agissait bien d’un marquis. Son marquisat, enfin ce qu’il en restait (une grosse demeure bourgeoise passablement délabrée au centre d’un domaine viticole inexploité depuis des lustres) était situé en Bourgogne.
Mais je ne souhaite pas en dire plus.
3.
Victor tu avançais titubant et grelottant vers le kapo. Là-bas dans ce monde glacé et barbelisé. Horrifique. 1943. Mauthausen…
Et tu me dis un jour qu’à ce moment-là tu pensais à ton frère Antoine lorsqu’à seize ans il jouait admirablement du Pachelbel au violon devant ton père et quelques femmes inconnues et toujours différentes. Et tu me confias que dans ce wagon à bestiaux où à deux cents entassés nus et les pieds souillés par vos excréments tu songeais à cette frêle jeune fille ; elle fut ta mère, cette personne fragile, gracile, désespérée sur une photo jaunie ayant pris la pause deux ou trois semaines avant de fuir ton marquis de père, homme autoritaire, sanguin, ignoble. Et tu ne la revis jamais. D’ailleurs, tu n’eus aucun autre souvenir d’elle sauf ce visage d’ange sur cet immémorial cliché lui-même disparu dans la tourmente.
Cette tempête fut un massacre.
Tu étais Diogène jeté chez les barbares. Non pas cherchant un homme, mais simplement une lueur d’espoir. De cet espoir aurait pu un jour émerger un pardon soutenable à tes propres yeux. Cela commença dans le wagon.
Dans ce train traversant l’Allemagne en si peu de jours, dont deux immobilisé on ne sait où, dans ce wagon à bestiaux, des hommes s’entraidaient pour uriner dans une vieille boîte de conserve. L’humiliation de déféquer, debout, aux yeux de tous, ajoutée à la faim, la soif, le froid et les douleurs rendirent certains d’entre eux, abêtis, agressifs, violents et injustes. Bourreaux à leur tour.
Finalement, ces gens si simples, la veille encore tamponnant dans un bureau, enseignant dans une école, cuisinant dans un restaurant, réparant dans un garage ou ajustant dans une usine, ce petit peuple ordinaire s’habituait. Jusque-là, il avait été confronté à des fins de mois passionnantes d’irrationalité avec périodes œufs à tous les repas, beurre du matin au soir puis plus rien pendant une semaine, aléas du marché noir, du bon vouloir des magouilleurs, mais enfin : on vivait dans le souvenir de ces jours si bien réglés, entre le labeur, les dimanches au bord de l’eau, les congés payés (ah les congés payés !)
Petit peuple français barbarisé par les barbares au point trop souvent de s’entre dénoncer…
Le marquis observa longuement ses congénères d’infortune et, me confia-t-il bien plus tard, sa première humiliation fut de prendre soudain conscience de son assimilation à cette populace. Comme les autres, Victor pissait et chiait debout, comme les autres il se surprenait à donner des coups de coude cruels pour se hisser vers un interstice afin de respirer un peu d’air frais, comme les autres il ressentait un certain soulagement et même une sorte de joie quand un corps inanimé glissait vers le bas, offrant ainsi un peu plus d’espace vital si cher à Adolf et un marchepied pour essayer de sortir la tête hors de ce cloaque.
Victor était âgé d’à peine trente ans. Un homme en début de course. Rien de plus.
23.
Le 4 février à midi (vingt-sept heures après la conquête de la première tour de garde), le commandant du camp de Mauthausen informa Berlin : seuls dix-sept évadés n’avaient pas été repris. Dont le marquis. Ils n’étaient plus que onze le lendemain. Victor était toujours parmi eux. Trois ou quatre (on ne sut jamais exactement) parvinrent à gagner la Tchécoslovaquie. Deux furent repérés dans les collines boisées du Waldviertel, mais ils réussirent à se faire passer pour des ouvriers agricoles. Ils ne furent pas renvoyés au camp.
Victor se retrouva dans un groupe de quatre survivants. Grâce à des hommes de peine, ils furent d’abord cachés dans une grange puis, avec l’aide de la famille d’un notaire, dans la cave d’une vieille ferme abandonnée.
L’homme de loi était Gonrad Mascherthaler.