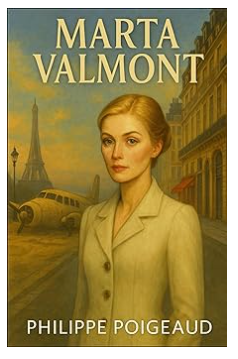Javier Milei semble être très à la mode à droite, en Europe et aux USA. Il est même apprécié, parfois, à gauche. Mais quel est son bilan depuis décembre 2023 (date de son accession au pouvoir) ?

Depuis l’arrivée au pouvoir de Javier Milei en décembre 2023, l’Argentine a connu des transformations économiques et sociales significatives. Face à une inflation annuelle atteignant 211,4 % en 2023, le gouvernement a mis en place des mesures d’austérité strictes et des réformes structurelles pour stabiliser l’économie. Ces actions ont permis de réduire l’inflation annuelle à 118 % (quand même !!) en 2024.
Mais si l’économie de l’Argentine sous la présidence de Javier Milei a montré des signes de stabilisation macroéconomique, elle a aussi eu de lourdes conséquences sociales. Milei a mis en œuvre une série de mesures libérales visant à stabiliser l’économie. L’Argentine a enregistré un excédent financier de près de 275 milliards de pesos (environ 309 millions de dollars) au premier trimestre 2024, une première depuis 2008. En 2024, l’excédent commercial a atteint un niveau record de 19 milliards de dollars, alors qu’en 2023, elle était déficitaire.
Milei a proposé la dollarisation de l’économie comme solution pour stabiliser la monnaie et réduire l’inflation. Cependant, cette mesure reste controversée et complexe à mettre en œuvre et est en stand-by. Le gouvernement a drastiquement réduit les dépenses publiques, notamment en diminuant les subventions et en limitant les programmes sociaux. Cela a permis de réduire le déficit budgétaire, mais au prix de très fortes tensions sociales. Par ailleurs, le gouvernement a lancé un programme de privatisations massives pour attirer les investissements étrangers et réduire le rôle de l’État dans l’économie.
Hausse de la pauvreté, tensions sociales
Cependant, ces mesures ont eu des conséquences sociales importantes. Au premier semestre 2024, le taux de pauvreté a atteint 57,4 %, le niveau le plus élevé depuis 2004. Bien que ce taux ait diminué à 38,9 % au troisième trimestre, il reste préoccupant. Les coupes budgétaires ont entraîné une réduction des services publics, affectant particulièrement les retraités, dont beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Bien que certaines réformes aient visé à stimuler l’emploi privé, le chômage et la précarité ont augmenté dans certains secteurs, notamment dans les industries dépendantes des subventions publiques.
Face à cette détérioration des conditions de vie, de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays. Les syndicats, les organisations sociales et les groupes de gauche ont organisé des protestations contre les mesures d’austérité. Par exemple, en septembre 2024, des milliers de retraités ont manifesté devant le Congrès pour dénoncer le veto présidentiel à une loi visant à augmenter les pensions, soulignant que leurs revenus ne suffisaient plus à couvrir leurs besoins essentiels. Les universités publiques ont également été fortement touchées par les réductions budgétaires. Le refus du gouvernement d’ajuster le financement universitaire en fonction de l’inflation a conduit à des grèves d’enseignants et à des occupations étudiantes. Les enseignants ont vu leur pouvoir d’achat chuter drastiquement, entraînant une « saignée » de chercheurs et d’enseignants quittant le secteur public pour le privé.
Contre la bureaucratie
Le gouvernement a supprimé l’Administration fédérale des recettes publiques (Afip), qui contrôle les douanes et le fisc, pour la remplacer par l’Agence de recouvrement et de contrôle douanier (Arca). Une structure plus agile et plus informatisée, avec des salaires moins élevés et des effectifs réduits à l’essentiel, notamment après le licenciement de 3 155 agents. Au total plus de 35 000 postes de fonctionnaires ont déjà été supprimés. Quant au gouvernement, il ne compte plus que neuf ministères (dix-huit auparavant). 200 services d’État ont par ailleurs été supprimés.
Les coupes budgétaires drastiques dans les services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des retraites, ont entraîné une augmentation notable de la pauvreté et du chômage. Entre décembre 2023 et août 2024, environ 180 000 emplois ont été supprimés, portant le taux de pauvreté à 58 % de la population.
L’économie argentine en 2024 reste fragile, avec des signes de stabilisation dans certains secteurs, mais des défis majeurs persistent. Les réformes de Milei pourraient potentiellement redynamiser l’économie à long terme, mais leurs coûts sociaux immédiats risquent de limiter leur acceptation et leur efficacité. La situation dépendra également de la capacité du gouvernement à négocier avec les créanciers internationaux et à attirer des investissements étrangers.
En résumé, l’Argentine en 2024 est un pays en transition, avec une économie en cours de restructuration mais des tensions sociales croissantes, reflétant les difficultés d’un changement radical dans un contexte déjà fragile.
Sources : médias argentins, presse brésilienne (Globo, Folha de SP), Le Point, l’Express, El País, archives personnelles.