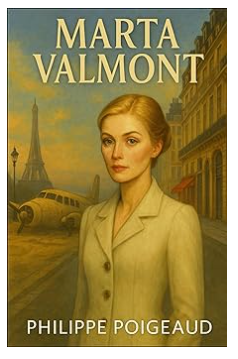Canaima, un site du patrimoine mondial menacé par l’exploitation minière et le tourisme sauvage
L’Unesco a demandé au gouvernement vénézuélien de prendre des mesures pour protéger l’un des sites les plus riches en biodiversité de la planète et de mettre à l’ordre du jour la visite de sa mission d’évaluation.

Le parc national Canaima ( Parque Nacional Canaima) est un parc national situé dans le plateau des Guyanes, au Venezuela dans l’État de Bolívar. Il a été créé en 1962. Il s’étend sur 30 000 km2 (surface équivalente à celle de la Belgique), jusqu’à la frontière du Brésil. 65 % de sa superficie est occupée par des plateaux rocheux appelés tepuys. C’est dans ce parc que l’on peut voir le fameux Salto Ángel, la chute d’eau la plus élevée du monde (979 m). Le parc forme un milieu biologique unique d’un très grand intérêt géologique. Leurs falaises escarpées et leurs cascades forment des paysages spectaculaires.

Début juillet, lors de la dernière session du Comité du patrimoine de l’Unesco à Paris, World Heritage Watch a présenté son rapport sur l’état de conservation du parc national de Canaima, qui a été ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de l’Unesco en 1994 et pourrait être déplacé sur une autre liste, celle des sites en danger, si l’État vénézuélien ne s’attaque pas à la crise provoquée par la prolifération de l’exploitation minière illégale, devenue un grave problème environnemental depuis la mise en place en 2016 de la zone d’extraction stratégique de l’Arc minier de l’Orénoque, et un tourisme exacerbé qui dépasse les capacités du site. En effet, dans l’Amazonie vénézuélienne,se déroule une crise qui passe inaperçue pour beaucoup de personnes extérieures à la région : l’exploitation minière illégale. En 2022, une enquête publiée dans EL PAÍS a identifié plus de 3 700 points d’activité minière et un réseau de pistes utilisées pour le trafic d’or et de drogue. L’extraction illégale de minerais, stimulée par la demande internationale et la crise économique locale, ne dévaste pas seulement l’environnement, mais modifie également la dynamique de la population, exacerbant la pression sur les villes intermédiaires et générant un impact direct sur les communautés indigènes et périurbaines de la région.
« Dans le parc, il y a plus de 1 500 hectares affectés par l’exploitation minière, que nous avons géoréférencés au mètre près », explique la socio-anthropologue Cristina Burelli, fondatrice de l’ONG SOS Orinoco, qui travaille avec l’organisation allemande World Heritage Watch sur le suivi environnemental de ce patrimoine. « La bordure sud-ouest du parc est absolument minée », ajoute-t-elle. On peut lire sur le site de l’ONG : « Au cours des 20 dernières années, le narco-État chaviste a montré des niveaux d’attention fluctuants, en particulier lorsque Chavez et Maduro étaient désireux de trouver de nouvelles sources d’argent. Au cours de cette période, le gouvernement a tenté de mettre en œuvre six programmes en partenariat avec différents pays. Le dernier en date est le plan Arco Minero, annoncé le 24 février 2016, qui vise à exploiter les vastes réserves d’or, de diamants, de coltan et d’autres minerais. Les résultats ont été catastrophiques à la fois pour la région, sa population et l’environnement, et auront probablement des effets tragiques durables, voire irréversibles, sur le Venezuela et au-delà ».
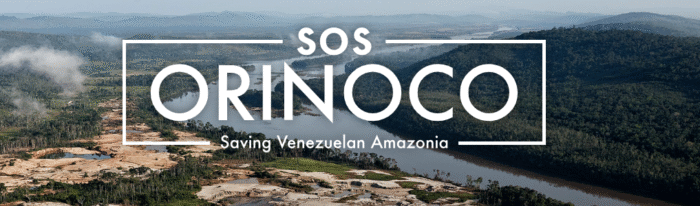
Les ONG ont documenté, à l’aide d’images satellites, l’expansion de la dégradation de l’environnement causée par l’exploitation minière. Il y a 25 ans, cette pratique ne concernait que 122 hectares. Aujourd’hui, avec la ruée vers l’or, ce sont plus de 1 582 hectares, soit une croissance de plus de 1 300 %, notamment dans ce que l’on appelle la zone tampon, une bande de protection non légale de 10 kilomètres mesurée à l’extérieur des limites officielles. Dans le dernier rapport présenté à l’UNESCO en juillet, 129 sites miniers sont signalés à l’intérieur du parc, sans compter les bassins d’extraction par dragage, qui sont difficiles à détecter, avertissent les chercheurs.
En plus des mines, il y a le tourisme sauvage. L‘Unesco « demande une stratégie de gestion du tourisme et des rapports sur les actions de prévention, de détection et de réponse à la présence d’espèces invasives susceptibles de se propager par le biais de l’augmentation du tourisme ». L’État vénézuélien doit présenter un nouveau rapport détaillé sur la situation avant le 1er février 2026.