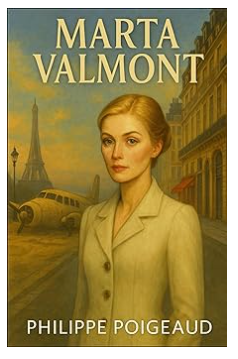Au Brésil, la culture immolée après l’incendie qui a ravagé le Museu Nacional
Comme beaucoup au Brésil, je suis restée pendant des heures hypnotisée devant la télévision à regarder les images du feu qui consumait le Museu Nacional dimanche 2 septembre au soir. Mais à la différence de la plupart des gens, j’essayais parmi les différentes images qui défilaient à l’écran d’identifier la fenêtre de mon bureau, avec l’espoir que de là je ne verrais pas ressortir les flammes. Un appel téléphonique de Rafael, avec qui je partage ce bureau, me sortit de cette rêverie : « Si, Aparecida, il brûle ! ». Quelques livres, des cassettes originales (mais déjà copiées !) de mes enregistrements auprès des Indiens Wari’, avec qui je travaille depuis 30 ans, un ordinateur, une caméra, des chaises, la table ronde où je discute avec les étudiants, les murs jaunes que j’avais moi-même peints ainsi que les petites sculptures de grenouilles instrumentistes, un souvenir de mon collègue et ami Gilberto Velho.

Il s’agit, je le sais, de pertes moindres si on les compare à celles de collègues qui ont perdu toute leur bibliothèque personnelle et tout leur matériel de recherche original. Et même infiniment petites, si on les compare aux collections d’objets, aux inventaires linguistiques et autres documents que des chercheurs du monde entier ont déposés au fil des siècles, en croyant qu’ils seraient à l’abri, accessibles à la postérité. Ils ne l’étaient pas. Et cela n’est pas la faute des courageux directeurs de notre musée, qui parcouraient sans cesse les différentes sphères du gouvernement fédéral où ils étaient traités comme des enfants réclamant un jouet tout neuf et superflu. Ils savaient – nous le savions tous – ce qu’il y avait dans ces murs et dans quel état : au bord de l’effondrement, rongés par les termites, attaqués par les fissures. Personne ne voulait arrêter de travailler, même dans des conditions précaires, ni arrêter d’appeler à l’aide.

Un musée créé par des visionnaires
Pendant plus de la moitié de ma vie, j’ai fréquenté presque tous les jours le musée, d’abord en tant qu’étudiante de master en anthropologie sociale, puis en thèse et, finalement, avec une fierté incontrôlable au cœur, comme professeure du programme d’études supérieures en Anthropologie sociale, le plus ancien du Brésil, créé en 1968, à l’apogée de la dictature militaire, par des enseignants visionnaires déterminés à construire un espace voué à la discussion de questions pressantes et à faire de la science au milieu du chaos politique.
Avant l’incendie, nous préparions la commémoration de notre cinquantenaire, un demi-siècle pendant lequel nous nous sommes maintenus comme l’un des meilleurs départements d’anthropologie du Brésil, et du monde. Parler du Museu Nacional dans n’importe quel milieu académique vous ouvre immédiatement les portes et impose le respect. Aujourd’hui, cela se reflète dans l’avalanche de messages que nous recevons de collègues partout dans le monde, consternés, prêts à offrir leur aide, des livres, des salles de cours.

« Nous savons que nous n’avons plus rien »
Lundi matin, nous étions devant le squelette du palais, dont on voyait encore la fumée sortir d’une des salles. On reconnaissait des morceaux de papier au milieu des cendres qui flottaient. Par sécurité, les pompiers ont interdit l’entrée. Consternés, nous nous interrogions sur ce qui aurait pu avoir survécu. Mais nous savons que nous n’avons plus rien : ni murs, ni salles de cours, ni collections, ni livres, puisque notre bibliothèque, la plus importante d’Amérique latine en anthropologie, a entièrement brûlé.
Nous, les professeurs d’anthropologie, docteurs, chercheurs de haut niveau du CNPQ (l’équivalent brésilien du CNRS), scientifiques de la FAPERJ (l’agence de soutien à la recherche de l’État de Rio de Janeiro), titulaires de prix, de médailles et d’une renommée internationale, sommes à présent une bande nomade de fonctionnaires de l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Lundi, devant le musée brûlé, nous nous sommes réunis au pied d’un arbre pour nous assurer les uns les autres qu’au moins, nous restons ensemble. Et avec nous, juste à côté, notre personnel, nos étudiants et anciens élèves, animés d’une énergie qui redonnerait espoir à n’importe quel sans-abri.
Un savoir perdu par des coupes budgétaires radicales
Comment ne pas s’émouvoir devant ces garçons et filles, si jeunes, qui pleuraient abondamment dans les bras les uns des autres ? Ils sont déterminés à continuer, tout comme nous. Et ne pensez pas que là, leurs conditions de travail étaient meilleures : la plupart d’entre eux n’avaient plus ni bourse ni financement pour la recherche, une conséquence des coupes budgétaires radicales perpétrées par le gouvernement.
Et la recherche est la base de notre travail. Les anthropologues se rendent dans des lieux lointains, vivent au milieu d’autres sociétés et d’autres peuples pendant des mois ou des années et reviennent pour nous raconter ce qu’ils y ont appris dans leurs thèses, articles, livres.
Grâce à eux, nous envisageons d’autres façons de vivre, nous avons accès à de précieuses connaissances, savoirs, techniques, langues, bref, à d’autres mondes, certains en voie de disparition, surtout maintenant, après que leurs derniers vestiges ont brûlé dans ces flammes effroyables. Un savoir perdu pour nous, pour nos descendants et pour les peuples autochtones eux-mêmes, qui fréquentaient le musée pour mieux connaître quelques-uns des objets produits par leurs grands-parents déjà décédés, ou pour redécouvrir la langue qu’ils ne savent plus parler.
« Nous avons pris le mort dans nos bras et avons chéri le cadavre de notre maison »
Nous sommes tous plus pauvres aujourd’hui, y compris les chefs du gouvernement et politiciens qui n’ont aucune idée de la gravité du désastre et donnent des interviews à droite et à gauche parlant de reconstruction, de restauration, comme s’il ne s’agissait que d’argent, lequel, d’ailleurs, commence à miraculeusement apparaître en ce moment.
Si le palais impérial peut, qui sait, être restauré, ce qu’il y avait dedans ne le sera jamais. Aucun argent ne pourra racheter notre collection, puisque ces objets, inventaires, documents, enregistrements, papiers, gravures, n’existent plus nulle part dans le monde.
En regardant le squelette de notre musée, il me vint l’image d’une immolation, de quelqu’un mettant le feu à lui-même pour protester, pour se révolter après tant de sévices et de négligence. Ayant compris son message silencieux et véhément, nous avons pris notre musée sur les genoux, comme nous le pouvions, en le pressant fort dans nos bras. Tous ensemble, professeurs, personnel, étudiants, nous avons pu rentrer malgré la brutalité des policiers qui jetaient leurs grenades lacrymogènes et repoussaient les gens réunis devant la porte d’entrée. Nous avons pris le mort dans nos bras et avons chéri le cadavre de notre maison.
Avoir à mes côtés mes étudiants, forts, main dans la main, pleins d’espoirs et de tendresse, m’a fait voir une facette plus belle du chaos et a ravivé mon espoir en l’avenir. Un pays en ruines, corrompu, sans aucun respect pour l’éducation et la culture, et ces étudiants montrant que ce qu’ils ont vécu là est crucial pour leurs existences et qu’ils sont prêts à lutter. Sachez, chers étudiants, que j’ai vécu auprès de vous quelques-uns des meilleurs moments de ma vie, que j’ai certainement plus appris de vous que je ne vous ai appris, et que je suis prête à continuer, à donner cours sous les arbres de notre jardin, si c’est nécessaire.
Texte traduit du portugais par le Collectif de soutien au Museu Nacional de Rio de Janeiro, publié conjointement par la revue L’Homme et le blog de la revue Terrain. Le texte original est paru en portugais dans le journal en ligne Nexo qui en a aimablement autorisé la reproduction.