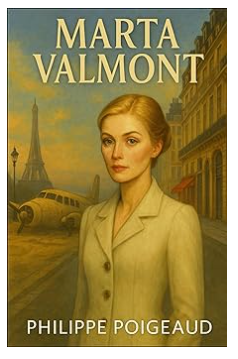Il y a cent ans, les hommes du village de Nagyrev, en Hongrie, étaient ivres et violents. Leurs femmes en avaient assez. Une sage-femme locale a alors proposé un plan. La journaliste Hope Reese a raconté cette histoire dans un livre :

Les femmes de Nagyrev étaient désespérées. Dans ce petit village agricole hongrois, à l’époque de la Première Guerre mondiale, nombre d’entre elles luttaient pour survivre. Elles souffraient aux mains de leurs maris violents, dont certains étaient des vétérans de guerre, d’autres incapables de travailler en raison de blessures, et souvent alcooliques.
Il s’agissait pour la plupart de familles agricoles pauvres et les femmes ne voyaient pas d’issue. En plus de s’occuper des enfants, des parents âgés et de leur maison, ces femmes ont également pris en charge la gestion des exploitations agricoles. La communauté était habituée à la violence. « Une femme est bonne lorsqu’elle est battue », disait un proverbe local.
Au fil du temps, une idée s’est imposée parmi les femmes du village. Cela a commencé par des chuchotements, des rumeurs sur quelques actes terribles, mais cela a fini par se répandre dans tout un réseau. Au total, 28 accusés – 26 femmes, 2 hommes – de Nagyrev et de la région de Tiszazug ont été accusés d’avoir assassiné 101 personnes pendant près de vingt ans, entre 1911 et 1929. Le nombre réel de personnes tuées pourrait s’élever à 300.
Les empoisonnements ont commencé en 1910
Le premier procès n’a eu lieu qu’en décembre 1929, au tribunal régional de la petite ville de Szolnok, à environ une vingtaine de kilomètres de Nagyrev. À l’époque, l’histoire avait suscité une certaine attention internationale, mais 90 ans plus tard, cette histoire est oubliée.
En 1910, lorsque les empoisonnements ont commencé, Nagyrev était un petit village de 1 500 âmes, (329 chevaux, 414 vaches, 1 274 porcs et 49 moutons). Aujourd’hui, il est encore plus petit (670 habitants).
Pour écrire son livre, Hope Reese s’est rendue plusieurs fois dans ce village depuis 2019 jusqu’à récemment. Elle raconte : « L’alcool était un problème avant même le début de la Première Guerre mondiale. Nagyrev, à 70 miles au sud-est de Budapest, sur la rivière Tisza, se trouve dans la plus grande région viticole de Hongrie, le Kunsag. Presque chaque maison possède un vignoble. Mais si la boisson a toujours fait partie de la vie quotidienne des hommes de Nagyrev, elle a atteint de nouveaux extrêmes au lendemain de la guerre, les hommes s’auto-médicamentant. La consommation d’alcool était exacerbée par les jeux. Bien que les jeux de cartes soient interdits, de nombreux hommes s’y adonnent, fêtant leurs victoires et compatissant à leurs défaites avec du palinka, une eau-de-vie hongroise traditionnelle. Ces jeux se terminaient souvent par une bagarre. Et la violence était régulièrement rapportée à la maison ».
Tante Zsuzsi était petite et trapue
Les maisons de Nagyrev étaient presque toutes des maisons de plain-pied en pisé avec des toits de chaume. La cuisine était la pièce la plus importante. C’est là que les femmes passaient le plus clair de leur temps, à cuisiner, à discuter avec leurs amies et à se plaindre de leur mari.
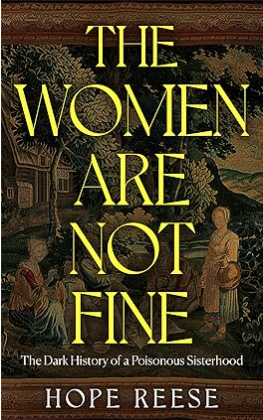
Une femme en particulier était présente pour écouter aux tables de cuisine. Il s’agit de la sage-femme officielle du village, Zsuzsanna Fazekas, que les femmes appelaient « tante Zsuzsi ». Elle est née à Nagyrev en 1862, mais en 1884, elle a déménagé dans le village voisin de Tiszainoka, où elle a épousé un pauvre fermier. Vers 1890, Zsuzsi retourne à Nagyrev avec ses trois enfants. Elle s’est éloignée de son mari. Il meurt en 1928, à l’âge de 68 ans, d’une insuffisance cardiaque. Certains villageois ont chuchoté qu’il s’agissait d’une mort par empoisonnement, et la police l’a plus tard désignée comme une suspecte probable. « Tante Zsuzsi était petite et trapue, avec d’épais cheveux noirs, des yeux enfoncés et des sourcils foncés et intenses. Ses lèvres formaient une petite ligne fine. Contrairement aux autres femmes du village, elle portait ses cheveux en chignon serré. C’était une rebelle à part entière, que l’on voyait souvent traîner dans le bar local, fumant sa pipe ou des cigares – des activités qui étaient largement interdites aux femmes. Et elle s’épanouissait dans ces environnements. C’était une marginale, une anticonformiste, une conteuse d’histoires, la vie de la fête ».
La sorcière rusée et sournoise
Le gouvernement préférait que les villages emploient des sages-femmes certifiées et Zsuzsi avait un diplôme de sage-femme de la ville de Nagyvarad. Nommée vers 1900, elle était l’une des rares femmes à pouvoir gagner de l’argent. Elle vivait dans une maison qui lui avait été offerte par le conseil du village et qui était la plus belle de la rue. Dans sa cuisine, le diplôme de Zsuzsi est suspendu au-dessus d’une armoire sur laquelle se trouve une rangée de bocaux. Certains de ces bocaux contenaient la préparation la plus recherchée de Zsuzsi : un élixir toxique à base de papier tue-mouches dissous. Il y avait un jardin de bonne taille à l’arrière et Zsuzsi y allait souvent pour s’occuper de ses nombreuses plantes et fleurs. « Plus tard, des fioles de poison ont été retrouvées enterrées dans la terre », explique l’auteur qui s’est livré à une véritable enquête policière.
Lorsque Zsuzsi a commencé à travailler à Nagyrev, le village n’avait pas de cabinet médical. En plus de ses fonctions de sage-femme, elle est donc devenue médecin de facto. Elle avait déjà soigné le juge du coin d’une hernie.
« Sa connaissance du corps humain et de la sexualité la faisait passer au mieux pour une « impure » – à l’époque, les sages-femmes étaient souvent considérées comme des prostituées. Sa connaissance des plantes et des remèdes la faisait parfois passer pour une sorcière auprès des villageois. Des insultes telles que « sorcière » et « salope » lui ont été lancées, mais rien ne prouve qu’elle ait tenté de dissiper ces croyances. La fonction de sage-femme de village lui conférait un certain prestige. On la laisse entrer chez les gens, elle apprend les secrets de chacun », écrit Hope Reese.
Papier tue-mouches : simple, pratique, commun, efficace !
La voisine de Zsuzsi était Maria Varga, la femme d’Istvan Joljart, un ancien combattant devenu aveugle pendant la guerre. Brutalement blessé sur le front russe, il avait été capturé comme prisonnier de guerre et avait passé cinq mois dans un camp de l’armée russe. Istvan souffrait de graves insomnies et de rage, passant souvent trois, quatre ou cinq jours sans dormir. Nourri par l’épuisement, la douleur, la panique et l’apitoiement sur lui-même, il disait à Maria qu’il aurait aimé être tué au combat. Jaloux et en colère, il la battait régulièrement.
Au cours de l’été 1916, les choses empirent à la maison pour Maria et le jeudi 16 août 1916, elle demande conseil à sa tante Zsuzsi pour « calmer » son mari. Zsuzsi lui fournit un élixir, soi-disant des gouttes pour l’estomac. Au début, l’insomnie d’Istvan semble s’améliorer – la toxine a un effet sédatif. Mais alors que Zsuzsi poursuit ses visites pour le soigner, l’élixir opère sa véritable magie. Près de trois semaines plus tard, le jeudi 21 septembre 1916, Istvan meurt.
La journaliste raconte : « À mesure que la nouvelle se répand, les femmes s’encouragent mutuellement à utiliser cette solution pour se débarrasser de leurs « mauvais » hommes. Zsuzsi s’est rapidement retrouvée à la tête d’une entreprise florissante – et c’était une femme d’affaires avisée. Mais elle se soucie aussi de ses clientes, qui sont souvent des amies. Elle faisait donc payer ces femmes sur une échelle mobile et acceptait également d’autres formes de paiement – œufs, jambon, poulet. Elle était même connue pour donner l’arsenic gratuitement ».
La veuve noire et la masseuse
Istvan n’était pas le premier homme de Nagyrev à mourir des mains d’une empoisonneuse. Et si Zsuzsi était considérée comme la meneuse, il y avait d’autres guérisseurs et anciens au cœur de cette sororité meurtrière, dont les connaissances en matière d’empoisonnement se transmettaient de génération en génération.
Rozalia Takacs est née à Nagyrev en 1862, la même année que tante Zsuzsi. Elle n’est allée à l’école que pendant trois ans et ne savait ni lire ni écrire. Pour gagner de l’argent, Rozalia devient masseuse et aide à soigner les malades. À 17 ans, en 1880, Rozalia épouse Lajos, un ivrogne qui la maltraite. Après trois décennies de mariage avec cette « bête alcoolique », Rozalia est désespérée. Lorsque Lajos est tombé malade à la fin de l’année 1910, des amis et des voisins, dont une veuve âgée, Roza Farkas, sont venus soutenir Rozalia. Certains d’entre eux ont encouragé leur amie à saisir l’occasion de « prendre soin » de son mari – de le tuer pendant qu’il était faible ! Bien que tante Zsuzsi soit responsable de nombreux empoisonnements perpétrés par la confrérie, c’est Roza qui a été la première à suggérer la méthode du papier tue-mouches… « Il est possible que Roza ait eu connaissance de cette méthode en raison d’une épidémie d’empoisonnement à plus petite échelle qui avait eu lieu dans la ville de Hodmezovasarhely, à un peu plus de 40 miles au sud de Nagyrev, en 1897. Ce scandale – surnommé « l’affaire Mari Jager » – impliquait une autre sage-femme, Mari Jager, qui aidait les femmes de la région à tuer leur mari en utilisant du papier tue-mouches dissous afin d’obtenir des indemnités d’assurance-vie ».
En 1911, l’acide arsenical pouvait être acheté sous forme de poudre comme raticide. Dans les dépositions au tribunal, les accusés ont également parlé de la « pierre à mouches », une roche recouverte d’une couche toxique naturelle de trioxyde d’arsenic. Pour extraire l’arsenic, les femmes faisaient tremper la pierre. Mais la concoction la plus populaire était obtenue en dissolvant du papier tue-mouches dans de l’eau ou du vinaigre – préparés dans la cuisine. Ils jetaient trois ou quatre bandes de papier tue-mouches Millios Legypapir, ou Million-Fly – un produit ménager composé d’une longue bande de papier recouverte d’une couche d’adhésif – dans une casserole.
Ils se procuraient le papier tue-mouches au magasin général Feldmayr, dans le centre de Nagyrev, ou dans une pharmacie des villes ou villages voisins – jusqu’à ce que le produit soit interdit en Hongrie en 1927 en raison de son lien présumé avec les empoisonnements.
Sept tentatives !
Rozalia a suivi les conseils de ses amis et de ses aînés, puis elle est allée voir sa tante Zsuzsi, qui lui a expliqué la méthode. Rozalia dissout trois feuilles de papier tue-mouches dans de l’eau. Elle l’a mélangé aux médicaments de son mari, l’a « traité » avec la potion, puis a attendu de voir ce qui se passerait. Sa tentative a échoué ; Lajos n’est pas mort. Elle a essayé sept fois avec l’arsenic liquide, sans succès. Finalement, en désespoir de cause, elle a acheté de l’acide arsenical – le produit qui tue les rats – et l’a moulu dans la bouillie de son mari.
Le 11 janvier 1911, une semaine après avoir mangé le repas, Lajos est finalement décédé. Il s’agit du premier empoisonnement réussi connu lié aux femmes Nagyrev – à ce stade, elles expérimentaient encore la méthode, les ingrédients et le dosage. Il s’agissait d’essais et d’erreurs.
Près de vingt ans plus tard, le 14 octobre 1930, Rozalia se présente à la barre. Non seulement elle admet avoir tué son mari, mais elle tire une « fierté perverse » de ce meurtre. Pour Rozalia, ce n’était que le début du travail qu’elle allait accomplir. Au cours des deux décennies suivantes, elle a aidé une demi-douzaine de femmes à empoisonner les hommes de leur vie, dont la plupart étaient violents.
Le meurtre des bébés
Les hommes n’ont pas été les seuls à être tués. De nombreuses femmes pauvres savaient qu’elles ne pourraient pas subvenir aux besoins de leurs nouveau-nés. Une femme de Nagyrev, Anna Cser, était enchaînée à une vie de privations. Ses difficultés ont commencé en 1909 lorsqu’elle a épousé l’aubergiste local et qu’elle a pris en charge les parents de son mari – une mère grabataire et aveugle et un beau-père malade et incontinent. Elle doit le nettoyer tous les jours pendant trois ans.
Mais le mari d’Anna était bien pire : il était infidèle, alcoolique et violent, même lorsqu’elle était très enceinte. « Lorsque le moment de l’accouchement approchait, il me battait encore », écrit-elle dans une déclaration à la police. « Il ne m’a jamais laissée seule. Il m’a donné un coup de couteau, a cassé la chaise sur moi. J’étais toute bleue ».
Lorsqu’elle donne naissance à son troisième enfant en 1916, Anna est épuisée et n’a plus de lait pour nourrir sa fille. En août 1916, avec l’aide de sa tante Zsuzsi, Anna a concocté une infusion d’eau sucrée avec une cuillère à café d’arsenic et l’a donnée au nourrisson. Le bébé n’a vécu que quelques jours…

La une d’un journal autrichien relatant l’affaire
Ce sont des dénonciations anonymes qui furent à l’origine d’une enquête, seulement à partir de juin 1929. Zsuzsi a été arrêtée le 29 juin, mais a nié toute implication et a été libérée sous caution. Il s’agissait toutefois d’une ruse : la police avait l’intention de la suivre, pensant qu’elle les mènerait à d’autres membres du réseau d’empoisonnement.
Tôt dans la matinée du 19 juillet, tante Zsuzsi entendit le crieur public appeler aux portes : la police parcourait la ville à sa recherche. La sage-femme savait qu’ils arrivaient et, depuis des jours, elle alternait entre arpenter les rues et se cacher dans sa maison. Zsuzsi a vu la police tourner au coin de la rue. Lorsqu’ils se sont rapprochés, elle a sorti de la poche de sa robe une fiole de solution d’arsenic et a avalé la potion.
Hope Reese écrit pour The New York Times et des dizaines d’autres publications – sur tous les sujets, de la culture au féminisme en passant par la technologie. Hope est l’un des auteurs de la collection Verso Books, Where Freedom Starts : Sex Power Violence #MeToo : A Verso Report.
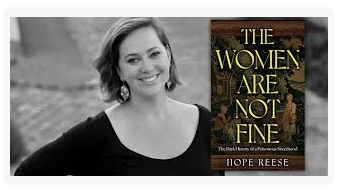
Auparavant, Hope était rédactrice à TechRepublic (CBS Interactive). Elle a enseigné le journalisme à l’université de l’Indiana, dans le sud-est. Hope a obtenu une maîtrise en journalisme à la Harvard Extension School tout en travaillant pour la Nieman Foundation for Journalism à Harvard.